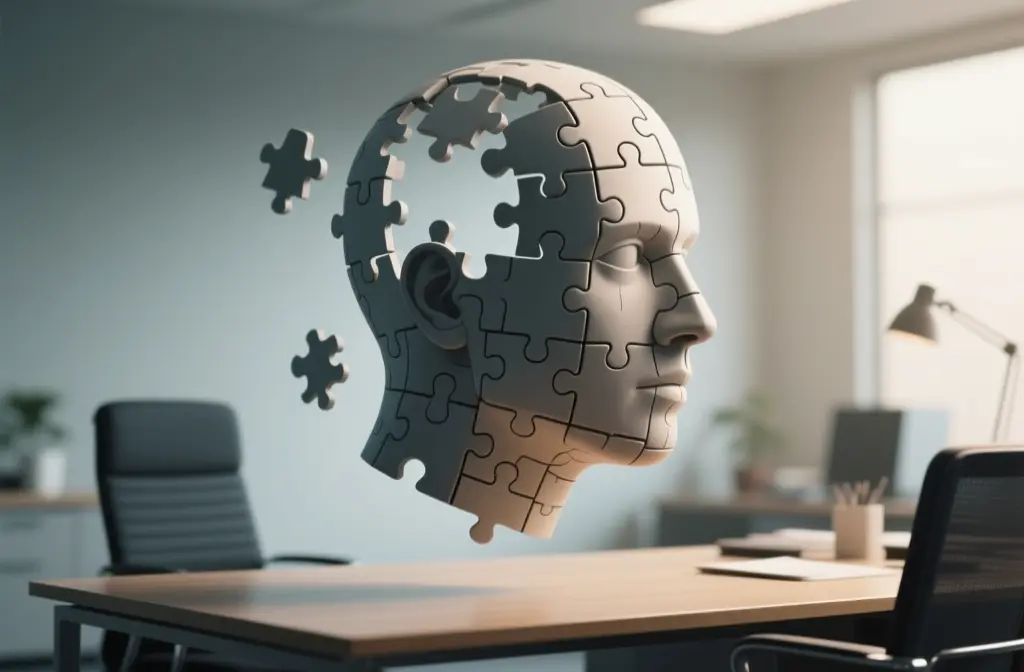Sous ses airs de sujet à la mode, la santé mentale au travail reste un impensé stratégique dans bien des entreprises.
Coût économique, désengagement massif, risques psychosociaux : l’addition est salée, mais les réponses restent timides.
Le sujet n’est pas une affaire de baby-foot ou de Chief Happiness Officer : il touche à la structure même du pouvoir et du management.
Un mal diffus, un coût massif
Tout le monde en parle. Peu savent vraiment de quoi il s’agit. La santé mentale au travail est devenue le marronnier préféré des cabinets de conseil, des séminaires RH et des journées de sensibilisation. Mais derrière les hashtags bienveillants, un constat brut s’impose : jamais le mal-être professionnel n’a été aussi répandu — et aussi peu traité comme un levier stratégique.
Difficile d’obtenir des chiffres homogènes, tant le sujet reste éclaté entre médecine du travail, services RH, mutuelles et assurances. Pourtant, les indicateurs convergent : hausse continue des arrêts maladie pour troubles psychiques, multiplication des signalements de burn-out, augmentation du présentéisme toxique (ces salariés qui viennent mais ne tiennent plus).
En France, selon le Baromètre ADP 2025, 64 % des salariés déclarent subir du stress au travail de façon régulière.
Les données de la DARES, elles, indiquent que 44 % des actifs disent penser à trop de choses à la fois, et 31 % se sentent sous pression. Des signaux préoccupants. Et plus d’un salarié sur cinq (21 %) est aujourd’hui en souffrance psychologique, selon le Baromètre Malakoff Humanis 2025. Une donnée qui reflète l’ampleur d’un malaise devenu structurel.
Mais l’impact ne s’arrête pas à la souffrance individuelle. Il se mesure aussi en euros. Coût de l’absentéisme, baisse de productivité, désengagement, turnover, erreurs, incidents de sécurité… Au Royaume-Uni, le cabinet Deloitte estimait en 2020 à 45 milliards de livres par an le coût du mal-être mental au travail. Un chiffre réévalué à 51 milliards en 2024.. En France ? Les estimations sont plus timides — voire inexistantes. Le tabou persiste, y compris dans les chiffres.
À cela s’ajoute une normalisation perverse : le stress est souvent considéré comme une conséquence logique de l’engagement. Une « preuve » d’implication. Pire encore : dans certains secteurs, le fait de tenir malgré l’épuisement est valorisé. Un signe de loyauté. Le salarié qui lève le pied est suspect. Celui qui craque est faible. Résultat : beaucoup préfèrent se taire, ou dissimuler leur fatigue sous des couches d’humour, de sarcasme ou… de surproductivité.
Ce mal diffus n’épargne aucun secteur. Ni les cols blancs, ni les cadres supérieurs, ni même les professions dites « vocations » (santé, éducation, culture). Il est alimenté par un cocktail bien connu : surcharge cognitive, injonctions contradictoires, perte de sens, temps morcelé, outils numériques envahissants, flou hiérarchique. Et dans un monde du travail hybride, dématérialisé, asynchrone ? L’isolement devient la cerise sur le gâteau.
Rien de neuf ? Certes. Mais ce qui change, c’est la masse critique. Il ne s’agit plus de cas isolés. La fatigue mentale est désormais un phénomène collectif — avec des conséquences systémiques. Et pourtant, dans bien des comités de direction, le sujet reste un angle mort.
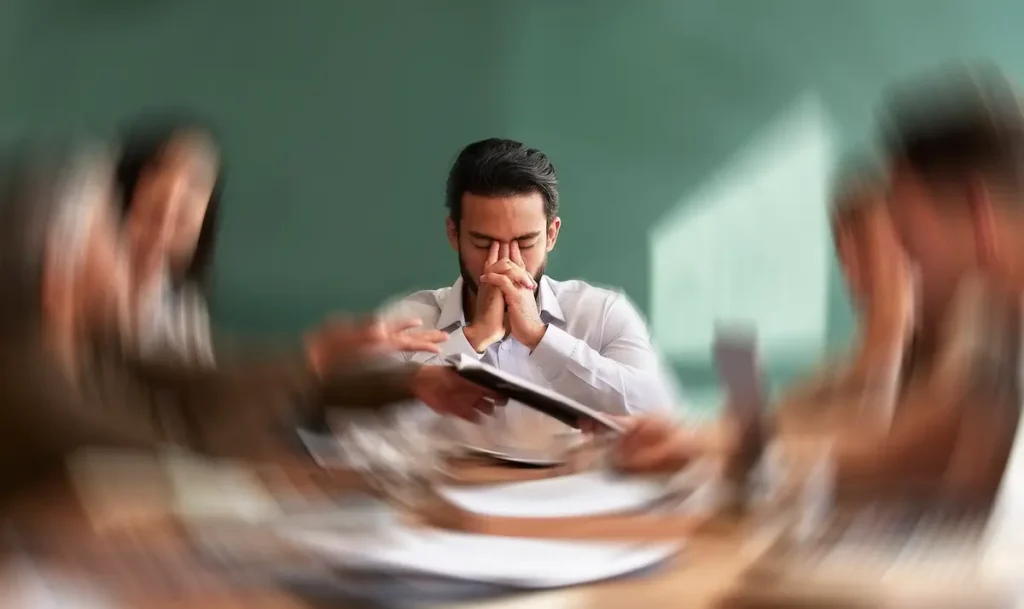
Des salariés en détresse, des entreprises encore frileuses
La détresse mentale n’est plus un sujet marginal réservé aux cellules de crise ou aux lignes d’écoute RH. Elle s’invite dans les couloirs, les open spaces, les réunions Zoom. Elle s’exprime par des signaux faibles : irritabilité, repli, absences récurrentes, performance en dents de scie. Et elle frappe large — du stagiaire au top management. Pourtant, face à cette montée en puissance, les réponses organisationnelles restent souvent superficielles, voire totalement déconnectées des réalités vécues.
Dans bien des cas, les entreprises se contentent d’actions symboliques. Une affiche dans la salle de pause. Un atelier « gestion du stress » une fois par an. Une newsletter sur la respiration en pleine conscience. Ou, grande tendance du moment : un « numéro vert » sous-traité à un prestataire externe. La santé mentale est traitée comme une externalité négative, un coût à contenir — et non comme une donnée intrinsèque de la performance durable.
Ce décalage entre discours et action crée une forme de cynisme chez les salariés. Car ils voient bien que les vrais déclencheurs de mal-être ne sont pas abordés : surcharge de travail, pression hiérarchique, absence de reconnaissance, ambiance délétère, injonctions paradoxales. Les causes systémiques sont mises sous le tapis, pendant que l’on distribue des tapis de yoga.
Certes, quelques entreprises commencent à s’emparer du sujet avec sérieux. Notamment celles qui ont mesuré l’impact direct sur leurs indicateurs clés : turnover, absentéisme, productivité, engagement. Mais elles restent minoritaires. Beaucoup se contentent encore d’un vernis « QVT » sans remise en question du modèle managérial. Dans les faits, parler de santé mentale revient souvent à individualiser un problème collectif.
Plus grave encore : certains DRH ou managers, pourtant bien intentionnés, n’osent pas aborder le sujet avec leurs équipes, de peur d’ouvrir une boîte de Pandore. « Si j’aborde la santé mentale, ils vont tous se lâcher », confie un dirigeant d’un grand groupe de services. Comme si le fait de ne pas en parler empêchait le problème d’exister.
Mais le silence n’est pas une option. Il alimente le malaise, accentue les fractures et empêche toute stratégie de prévention. Le vrai défi ? Passer d’une logique réactive à une approche systémique et intégrée — où la santé mentale devient un indicateur de pilotage au même titre que la marge brute ou le NPS.
Le management au cœur du problème… et de la solution
La majorité des salariés ne quittent pas une entreprise : ils quittent un manager. L’adage est connu, parfois galvaudé, mais il n’en reste pas moins vrai — surtout lorsqu’il est question de santé mentale. Car derrière chaque burn-out, chaque crise de nerfs contenue dans un bureau vitré, chaque pleur dissimulé en visio, il y a rarement une fiche de poste ou un outil numérique. Il y a un mode de management.
Or, c’est bien ici que le bât blesse. Le management intermédiaire est souvent laissé seul face à des injonctions paradoxales : exiger plus avec moins, motiver sans promettre, gérer l’humain sans y consacrer de temps. Le tout dans un contexte mouvant, avec des équipes hybrides, des outils qui changent tous les six mois, et une culture d’entreprise qui valorise… la résilience. Traduction ? « Débrouille-toi, et ne te plains pas. »
Résultat : les managers sont à la fois déclencheurs et victimes. Selon le Baromètre Malakoff Humanis 2025, 62 % des managers se sentent eux-mêmes fragilisés face aux situations de fragilité de leurs équipes.. Et pourtant, c’est vers eux que l’on se tourne pour détecter les signaux faibles, gérer les conflits, écouter, soutenir, arbitrer, rassurer. Sans formation, sans accompagnement, sans espace de parole.
Ce déséquilibre produit deux réactions classiques. La première : l’autoritarisme défensif. Le manager serre la vis pour garder le contrôle. La seconde : la fuite. Désengagement, absentéisme déguisé, repli dans l’opérationnel. Dans les deux cas, la santé mentale des équipes se dégrade.
| Erreurs managériales fréquentes | Alternatives saines |
|---|---|
| Sur-contrôle quotidien | Autonomie avec cadre clair |
| Réunions à rallonge sans objectif | Rituels courts et utiles |
| Aucune reconnaissance | Feedback régulier et sincère |
Le changement de culture est possible. Il demande du courage. Et un alignement entre les discours et les pratiques. La santé mentale n’est pas incompatible avec l’exigence. Elle est une condition de sa durabilité.
Que font les DRH ? Entre rôle pivot et marge réduite
Longtemps cantonnés à la gestion administrative ou à la prévention juridique, les DRH sont aujourd’hui en première ligne sur les questions de santé mentale. Et paradoxalement, rarement outillés pour y faire face. Entre la pression budgétaire, les exigences de conformité, les injonctions à l’innovation RH et la multiplication des alertes sociales, leur marge de manœuvre est souvent aussi étroite qu’illusoire.
Le discours officiel, bien sûr, est rodé : engagement pour le bien-être des collaborateurs, politique de qualité de vie au travail, partenariats avec des prestataires de soutien psychologique. Mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Les DRH doivent composer avec des directions générales encore frileuses à investir sur ce sujet, des managers débordés et des salariés de plus en plus critiques vis-à-vis de dispositifs qu’ils jugent cosmétiques.
Beaucoup de directions RH sont pourtant sincèrement mobilisées. Elles savent que la santé mentale est devenue un indicateur stratégique. Elles voient les signaux faibles remonter — souvent trop tard, souvent via des canaux informels. Mais leur posture reste fragile : comment défendre une politique de prévention cohérente quand les budgets sont gelés et que la logique de court terme domine ?
Autre écueil : l’atomisation des responsabilités. La santé mentale est parfois renvoyée à la médecine du travail, à un service RSE ou à une direction de la communication interne. Résultat : les actions sont dispersées, les priorités floues, et le pilotage inexistant. Il manque un véritable alignement stratégique, qui place la santé psychique des collaborateurs non pas comme un sujet périphérique, mais comme un pilier de la performance globale.
Pour sortir de cette impasse, certaines entreprises commencent à nommer des référents « santé mentale », à former les RH à la détection des risques psychosociaux, à intégrer des indicateurs de bien-être dans les tableaux de bord de pilotage. Mais il reste du chemin. Et surtout une question essentielle : quelle vision du travail porte l’entreprise ? Tant que la santé mentale sera pensée comme une variable d’ajustement, les DRH resteront des pompiers désarmés.
Vers une stratégie globale de santé mentale en entreprise ?
Les entreprises qui s’en sortent le mieux aujourd’hui ne sont pas celles qui ont installé des babyfoots ou multiplié les ateliers de sophrologie. Ce sont celles qui ont compris une chose simple : la santé mentale ne se pilote pas avec des rustines, mais avec une stratégie.
Cela suppose de passer d’un registre compassionnel (« on vous écoute ») à une approche systémique (« on agit sur les causes »). Et pour cela, il faut du courage. Du courage pour auditer franchement l’organisation du travail. Pour interroger les pratiques managériales, les objectifs, les outils numériques, le rythme des réunions, les silences hiérarchiques. Pour sortir du mythe de la résilience individuelle et assumer une responsabilité collective.
Certaines entreprises l’ont fait. Leurs points communs ? Des dirigeants impliqués, des politiques RH intégrées, une évaluation régulière du climat psychologique, et une gouvernance qui ne traite pas la santé mentale comme un sujet annexe. Elles intègrent la santé mentale dans leur raison d’être. Elles forment leurs managers en continu. Elles acceptent d’adapter les charges de travail. Et surtout, elles posent des limites claires — y compris pour elles-mêmes.
Ce virage n’est pas philanthropique. Il est stratégique. Car dans un marché de l’emploi tendu, face à une nouvelle génération plus sensible au bien-être qu’aux stock-options, la santé mentale est devenue un avantage concurrentiel. Les entreprises qui ignorent cette dynamique s’exposent à une fuite des talents… ou à une implosion interne.
La santé mentale au travail n’est pas le nouveau « greenwashing RH ». C’est le test de crédibilité ultime des organisations. Celui qui distingue les entreprises qui se transforment — des autres.